Avec (Foradan), nous étions là en 2004 à la BnF. Nous étions ensemble à Cerisy-la-Salle en 2012 et à Rambures en 2008, et les choses ont beaucoup avancé, et collectivement. Petit à petit, Tolkien a été de plus en plus pris au sérieux comme auteur de fantasy à l’œuvre extrêmement diverse. Le soutien de la BnF et le fait que, dès début 2016, la BnF ait décidé grâce à Thierry Grillet (direction de la diffusion culturelle, NDLR) de consacrer une exposition de 1 000 m² à Tolkien a été un moment extrêmement important.
L’idée était de ne pas reprendre l’exposition de la Bodleian (Library d'Oxford en 2018), parce que celle-ci était une petite exposition dans un lieu de pèlerinage pour les lecteurs de Tolkien – et les personnes qui étaient capables de lire les textes manuscrits. À la BnF, l’enjeu était de faire découvrir Tolkien dans toute sa diversité à un public de lecteurs, d’amateurs de fantasy, mais aussi au grand public, qui ne connaît pas toujours Tolkien et qui en a parfois une image un peu tronquée. L’objectif était aussi de proposer, par exemple pour les enfants, de visiter une partie de l’exposition. On sait que les publics de scolaires vont aller visiter le Comté des Hobbits, puis vont venir voir Monsieur Merveille, Roverandom et Les Lettres du Père Noël.
Il faut que chacun se sente libre de s’emparer de l’exposition dans sa totalité ou de petites parties. Vous avez fait un tour : cela nécessite plusieurs visites, tranquillement, à tête reposée.
Comment est venue l’idée d’une exposition de 1 000 m² à la BnF, justement ?
En 2004, Thierry Grillet avait vraiment beaucoup aimé organiser la petite exposition autour des illustrations d’Alan Lee et de John Howe. Il avait vu, lors de la journée d’études, l’engouement considérable du public pour Tolkien. Les deux auditoriums étaient pleins, il y avait des caméras pour retransmettre en direct dans le petit auditorium. Il avait donc gardé en mémoire de faire quelque chose autour de l’invention de mondes en littérature. Et puis, au fil des discussions avec la Bodleian, l’idée s’est imposée que J.R.R. Tolkien méritait une exposition en soi. J’ai été invité, début 2016, à des réunions de travail, qui, petit à petit, ont donné forme à l’exposition. Il y a eu une première commissaire interne à la BnF, avec qui j’ai travaillé pendant un an et demi à peu près (Louise Fauduet, NDLR). Nous avons choisi les pièces de la Bodleian, puis une nouvelle équipe BnF s’est formée, dont font partie Frédéric Manfrin et Émilie Fissier, Elodie Bertrand et les deux chefs de projet, Anne Manouvrier et Aurélie Brun. Ça a été une élaboration collective.
Frédéric Manfrin est spécialisé en histoire, et vous, en littérature. Vous avez donc chacun apporté une perspective différente ?
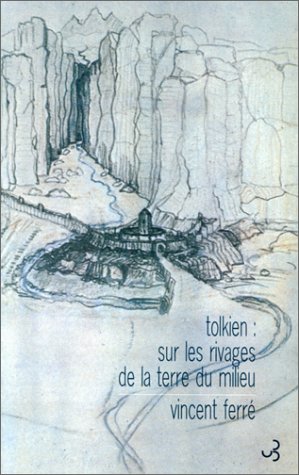 Tout à fait. Frédéric Manfrin et Émilie Fissier, qui fait partie du même département à la BnF, ont travaillé sur les pièces de contextualisation. De mon côté, j’étais l’expert extérieur chargé de tout ce qui concernait Tolkien : par exemple, de sélectionner dans les archives de la Bodleian et dans les archives de (l'université de) Marquette des pièces que j’ai présentées à l’équipe en expliquant leur intérêt. J’ai procédé à une sélection large et une sélection plus restreinte. Mon grand plaisir a été que toutes les pièces de la sélection large ont finalement été sélectionnées. C’était un rêve !
Tout à fait. Frédéric Manfrin et Émilie Fissier, qui fait partie du même département à la BnF, ont travaillé sur les pièces de contextualisation. De mon côté, j’étais l’expert extérieur chargé de tout ce qui concernait Tolkien : par exemple, de sélectionner dans les archives de la Bodleian et dans les archives de (l'université de) Marquette des pièces que j’ai présentées à l’équipe en expliquant leur intérêt. J’ai procédé à une sélection large et une sélection plus restreinte. Mon grand plaisir a été que toutes les pièces de la sélection large ont finalement été sélectionnées. C’était un rêve !Début 2018, je suis allé une semaine à Marquette compulser les archives et regarder toutes les microfiches, des milliers de pages, en choisissant 80 documents. Bill Fliss, l’archiviste, a sorti tous les originaux au fur et à mesure, selon un protocole rigoureux que vous imaginez. Par la suite, les dialogues entre institutions ont permis d’obtenir l’accord de Marquette pour un prêt de la totalité de cette liste, ce qui est considérable. 160 pièces proviennent de la Bodleian, mais moitié autant proviennent de Marquette ce qui, proportionnellement, est énorme.
Comment s’est fait le choix des pièces ?
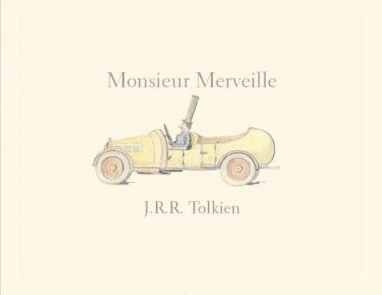 Dans mon esprit, il s’agissait à la fois de présenter, comme je le disais tout à l’heure, des reliques pour les amateurs de Tolkien, des choses dont on parle souvent mais sans les avoir vues – les phases de la Lune, les questions que se pose Tolkien sur l’intrigue du Seigneur des Anneaux, des manuscrits – et de choisir de belles pièces. Il y a par exemple un manuscrit calligraphié correspondant à un passage avec Treebeard (Barbebois, Sylvebarbe), un personnage qui a beaucoup évolué dans l’esprit de Tolkien, et de l’écriture elfique. J’ai essayé de faire quelque chose d’équilibré, qui inclurait aussi des pièces moins attendues. On connaît le livre Monsieur Merveille – Mister Bliss – mais on ne voit généralement pas cet ensemble d’illustrations. Personnellement, découvrir le manuscrit original m’a fait un choc. J’ai donc pensé à vous, puisque nous travaillons en confiance depuis vingt ans, et je me suis demandé ce que les lecteurs qui aiment Tolkien seraient heureux de voir.
Dans mon esprit, il s’agissait à la fois de présenter, comme je le disais tout à l’heure, des reliques pour les amateurs de Tolkien, des choses dont on parle souvent mais sans les avoir vues – les phases de la Lune, les questions que se pose Tolkien sur l’intrigue du Seigneur des Anneaux, des manuscrits – et de choisir de belles pièces. Il y a par exemple un manuscrit calligraphié correspondant à un passage avec Treebeard (Barbebois, Sylvebarbe), un personnage qui a beaucoup évolué dans l’esprit de Tolkien, et de l’écriture elfique. J’ai essayé de faire quelque chose d’équilibré, qui inclurait aussi des pièces moins attendues. On connaît le livre Monsieur Merveille – Mister Bliss – mais on ne voit généralement pas cet ensemble d’illustrations. Personnellement, découvrir le manuscrit original m’a fait un choc. J’ai donc pensé à vous, puisque nous travaillons en confiance depuis vingt ans, et je me suis demandé ce que les lecteurs qui aiment Tolkien seraient heureux de voir.La décision a été prise par la BnF et le Tolkien Estate de se concentrer sur Tolkien, sans rien de postérieur à sa mort (en 1973, NDLR), ce qui permettait d’avoir beaucoup d’espace pour présenter les pièces.
Par moments, je prenais du recul, en me demandant ce qu’il était juste ou judicieux de présenter également au grand public, aux non-lecteurs de Tolkien. Les réactions des journalistes depuis le vernissage presse du 21 (octobre 2019, NDLR) sont très encourageantes, parce que nous avons l’impression d’être parvenus à un équilibre.
Le Tolkien Estate a en effet suivi d’assez près l’élaboration de l’exposition. Il est souvent assez strict sur l'utilisation de l'œuvre et du nom de Tolkien, semble-t-il ?
C'est vrai, oui. Nous avons aussi eu un soutien moral formidable de la part de Christopher et de Baillie Tolkien (ex-secrétaire de John Ronald, éditrice des Lettres du Père Noël et épouse de Christopher, NDLR). Je suis allé travailler chez eux, et c’était merveilleux de sentir que le projet avait du sens à leurs yeux.
D'ailleurs, Christopher travaillait encore sur La Chute de Gondolin, ce qui n’était pas prévu.
Tout à fait – de même que Beren et Lúthien. Dans Beowulf, en 2014, il affirme que c’est « probablement » son dernier livre. Il faut prêter attention aux modalisateurs ! On ne peut qu’en être heureux ! Mais je pense qu’il était parfaitement sincère à l’époque.
Baillie, Christopher et Adam Tolkien sont des gens dont nous avons le soutien. Cela se voit dans le fait qu’Adam va venir parler, le 14 novembre, de son rapport à l’œuvre de son grand-père.
Justement, pouvez-vous nous parler un peu du programme de conférences qui ont lieu autour de l'exposition ?
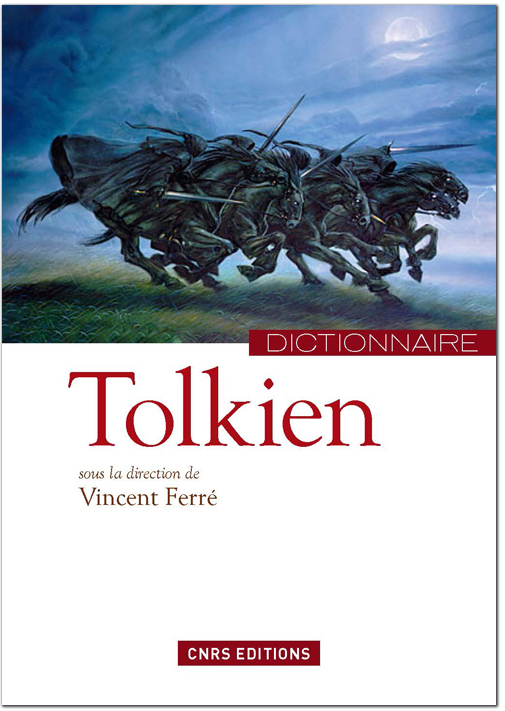 Dans le même esprit d’ouverture, il s’agit de présenter différentes facettes de l’œuvre au grand public, et ce, à plusieurs voix. Au début, j’ai beaucoup porté la voix médiatique, puis j’ai de plus en plus essayé d’aller vers une prise de parole à plusieurs. Le Dictionnaire Tolkien était une sorte de polyphonie réunissant 60 personnes ; de la même manière, il y a des noms très connus des lecteurs de Tolkien, comme Leo Carruthers ou Isabelle Pantin, qui vont donner des conférences. Pour les langues, on ne fait pas mieux en France que Damien Bador. Enfin, outre Alan Lee, Christine Laferrière, traductrice de Tolkien, va venir parler.
Dans le même esprit d’ouverture, il s’agit de présenter différentes facettes de l’œuvre au grand public, et ce, à plusieurs voix. Au début, j’ai beaucoup porté la voix médiatique, puis j’ai de plus en plus essayé d’aller vers une prise de parole à plusieurs. Le Dictionnaire Tolkien était une sorte de polyphonie réunissant 60 personnes ; de la même manière, il y a des noms très connus des lecteurs de Tolkien, comme Leo Carruthers ou Isabelle Pantin, qui vont donner des conférences. Pour les langues, on ne fait pas mieux en France que Damien Bador. Enfin, outre Alan Lee, Christine Laferrière, traductrice de Tolkien, va venir parler.Là encore, à partir des suggestions que j’ai pu faire à la BnF, l’équipe de programmation a tranché. De la même manière, ils ont arrêté un sujet de colloque autour de « Tolkien et la guerre » pour janvier, puis, de proche en proche, ont contacté tel ou tel intervenant.
Y a-t-il eu des résistances à faire comprendre que Tolkien est bel et bien un grand auteur ?
Pas à la BnF. C’est stupéfiant de voir le chemin parcouru et l’adhésion des interlocuteurs au sein des départements. La BnF compte 2 000 personnes. Dans chaque département où nous sommes allés pour parler de l’exposition en 2017, avec Louise Fauduet, et demander si les gens pensaient à des documents ou des manuscrits que l’on pourrait mettre en relation, nous avons toujours trouvé un correspondant qui était intéressé par le projet. Je travaille à la BnF depuis vingt ans en tant que lecteur, pour mes recherches. Ça a été un vrai plaisir de découvrir les coulisses et de collaborer au montage d’une exposition qui valorise ses collections.
Avez-vous une pièce préférée dans l’exposition ?
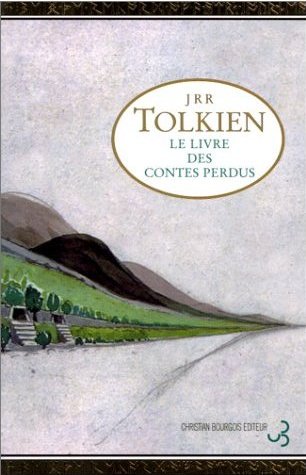 J’ai envie de vous montrer la dernière salle, que l’on pourrait appeler « l’œuvre d’une vie ». Vous avez ici un résumé de toute la trajectoire de Tolkien. On y trouve Le Silmarillion, avec les cartes des premiers manuscrits. Il y a derrière nous Le Livre d’Ishness, un ensemble d’aquarelles et d’illustrations de Tolkien étudiant, ses paysages mentaux, des représentations de ce qu’il visualisait. Et il y a ici cette vitrine que j’adore, parce qu’elle se rapporte au Seigneur des Anneaux, avec des pièces iconiques, comme des notes prises par Tolkien quand il se posait des questions sur l’évolution de l’histoire. J’en ai transcrit une partie, qui se trouve dans les cartels. C’est le moment où l’auteur se demande comment inventer la suite du Hobbit, où placer les Elfes, si Bilbo va disparaître lors de son anniversaire… Un tel ensemble vaut vraiment la peine d’être regardé de très près. Nous avons ici des manuscrits à l’encre bleue, retravaillés en rouge, en noir, au crayon, etc. Plus loin on trouve les fameuses phases de la Lune. On sait que Tolkien écrivait ses chapitres en tenant compte des phases de la Lune – nous voilà face à ce petit document ! Les distances parcourues par les Orques sont placées à côté.
J’ai envie de vous montrer la dernière salle, que l’on pourrait appeler « l’œuvre d’une vie ». Vous avez ici un résumé de toute la trajectoire de Tolkien. On y trouve Le Silmarillion, avec les cartes des premiers manuscrits. Il y a derrière nous Le Livre d’Ishness, un ensemble d’aquarelles et d’illustrations de Tolkien étudiant, ses paysages mentaux, des représentations de ce qu’il visualisait. Et il y a ici cette vitrine que j’adore, parce qu’elle se rapporte au Seigneur des Anneaux, avec des pièces iconiques, comme des notes prises par Tolkien quand il se posait des questions sur l’évolution de l’histoire. J’en ai transcrit une partie, qui se trouve dans les cartels. C’est le moment où l’auteur se demande comment inventer la suite du Hobbit, où placer les Elfes, si Bilbo va disparaître lors de son anniversaire… Un tel ensemble vaut vraiment la peine d’être regardé de très près. Nous avons ici des manuscrits à l’encre bleue, retravaillés en rouge, en noir, au crayon, etc. Plus loin on trouve les fameuses phases de la Lune. On sait que Tolkien écrivait ses chapitres en tenant compte des phases de la Lune – nous voilà face à ce petit document ! Les distances parcourues par les Orques sont placées à côté.C’est une pièce que j’aime particulièrement, car un petit panneau rend hommage à ce que Christopher Tolkien a fait pour l’œuvre de son père. Évidemment, sans lui, on ne connaîtrait presque rien d’autre que Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. La boucle est bouclée, à côté de la belle tapisserie venue d’Aubusson, avec Les Contes perdus. C’est par cela que tout a commencé, vous le savez, quand, alité par la fièvre qu’il a contractée dans les tranchées, Tolkien a écrit ses premières histoires. Nous avons ici la couverture des Contes perdus – avec, à notre droite, Le Lai de Leithian, une des histoires de ces mêmes Contes perdus – qui vont être fondamentaux pour la naissance de la mythologie.
Nous nous quittons sur cette belle présentation… Merci beaucoup, Vincent Ferré !
À très bientôt dans l'exposition !
''Propos recueillis par Foradan et Izareyael et transcrits et mis en forme par Saffron et Izareyael. Conversation enregistrée le 21 octobre 2019 à la Bibliothèque nationale de France François-Mitterrand.''


