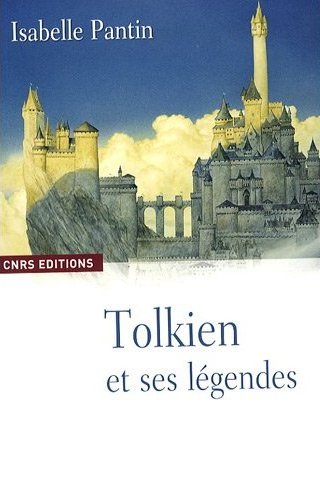Cet ouvrage est le premier d'une nouvelle collection des éditions du CNRS qui "entend étudier la réception du moyen age aux siècles ultérieures dans le domaine des arts et de la littérature."
Et c'est avec l'étude de Tolkien et de son œuvre sous cette lumière que nous découvrons que "la réalité de la perception d'une œuvre par ses lecteurs ne se confond pas avec la manifestation massive de son succès. Mais si ce succès dépasse un certain degré, il peut sembler qu'il n'y ait plus ni demande, ni réponse possible, mais comme une angoissante saturation. Il est donc naturel de désirer se replier à l'intérieur de l'œuvre en cherchant à y retrouver des lieux où l'air circule : en lui redonnant aussi la mesure d'une création humaine que chacun peut peut explorer, interroger et librement quitter."
L'ensemble du livre pose la question sur la relation qui peut exister entre l'œuvre de l'écrivain et l'histoire de son époque : Tolkien a fait le choix de composer des histoires se rattachant aux modèles du mythe et de l'épopée, relevant d'un réalisme tout autre que celui de la tranche de vie ou de la vérité psychologique, profondément émouvantes et écrites d'une façon très lisible ; des histoires définies non par l'appartenance à un genre, mais par la sorte d'expérience offerte au lecteur.
La présence de l'univers de Tolkien vient de ce qu'il possède plusieurs dimensions, dont le temps, avec une conscience très vive du très proche et du très lointain et en évolution constante.
Cet essai étudie la personnalité de Tolkien, ses convictions, ses amitiés, ses inspirations, révélant des facettes trop méconnues (et qui répondent brillamment à la question du fascisme chez Tolkien entre autres) dans la composition des légendes ainsi que dans la personnalité de l'auteur.
Ensuite, apparaît une étude du sens tragique, de la signification et de la comparaison avec les légendes chères à Tolkien que l'on retrouve à tout instant du Silmarillion.
Enfin, toute la dernière partie décrypte "le Monde" du Légendaire, comment et pourquoi il a pris cette forme si proche et si lointaine à la fois, ce qui fait, en somme, pourquoi la sous-création d'un professeur de philologie d'Oxford, son invention de toutes pièces, a pris une telle consistance, débordant du livre qui l'a porté pour demeurer à l'orée de la pensée, comme s'il suffisait d'un rien pour fouler le sol d'Arda.
— Foradan